La Loutre
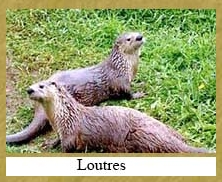
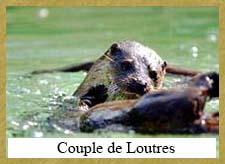 La Loutre a fait son retour. Après avoir été décimée, pour sa fourrure, par la chasse et le piégeage, la loutre est un animal protégé depuis 1972 et connaît une rapide extension dans le bassin de l'Oust. Une vingtaine d'individus ont été recensés le long de la rivière ; cela peut paraître peu, mais il s'agit là d'un mammifère de grande taille, doublé d'un super prédateur impliquant des densités faibles (les domaines individuels varient de 10 à 25 kilomètres de cours d'eau pour une femelle reproductrice, jusqu'à 40 kilomètres pour un mâle adulte).
La Loutre a fait son retour. Après avoir été décimée, pour sa fourrure, par la chasse et le piégeage, la loutre est un animal protégé depuis 1972 et connaît une rapide extension dans le bassin de l'Oust. Une vingtaine d'individus ont été recensés le long de la rivière ; cela peut paraître peu, mais il s'agit là d'un mammifère de grande taille, doublé d'un super prédateur impliquant des densités faibles (les domaines individuels varient de 10 à 25 kilomètres de cours d'eau pour une femelle reproductrice, jusqu'à 40 kilomètres pour un mâle adulte).
C’est [4] sans doute à partir de la population du bassin du Brivet et notamment de la Grande Brière où, même aux heures les plus noires de l'espèce en France, la Loutre a toujours été présente, que le retour s'est effectué sur le bassin de la Vilaine. En effet, les indices de présence ou de passage ont d'abord été notés (R. Gomes, 1994 ; M. Pondaven, 1995 ; D. Montfort, 1998) en limite de partage des eaux des deux bassins : Isac, Canal de Nantes à Brest, Fégréac, Sévérac, Saint-Dolay ; il faut d'ailleurs signaler que ce même noyau briéron de population a également été vraisemblablement à l'origine de la reconquête par la loutre des marais de l'Erdre, via le canal de Nantes à Brest.
En ce qui concerne les Marais de la Vilaine, on ne peut toutefois pas exclure que l'origine de certains individus « pionniers » soit aussi morbihannaise, Pen Mur, Noyalo. Le domaine vital des mâles adultes pouvant en effet, en raison de son ampleur de 20 à 40 km de rivière et de l'erratisme concomitant de l'actuelle dynamique démographique générale, autoriser ce genre d'hypothèse.
Lionel Lafontaine confirme l'extension de la loutre sur les bassins de l'Oust, du canal de Nantes à Brest, de l'Arz, de l'Aff. Il est surtout intéressant de noter une part nouvelle de retour qui apparaît sur des bassins en périphérie de ces derniers. À noter, en particulier, une extension remarquable dans les Côtes-d'Armor ou même en Ille-et-Vilaine (Couësnon, Vilaine). Toutefois, ces données trop récentes sont insuffisantes pour préciser le statut de l'animal sur ces nouveaux bassins : individus erratiques, sédentarisation effective, reproduction. Un suivi ultérieur permettra d'affiner les nécessaires connaissances.
À l'occasion des investigations préalables à la réalisation du Document d'Objectifs Natura 2000 (I.A.V., DIREN), le bureau d'étude Ouest Aménagement a procédé en 2005 à une série de vastes prospections de terrain, à partir des bases protocolaires consacrées, à savoir la recherche d'indices de présence et/ou passage de la Loutre, à l'occasion des visites d'ouvrages hydrauliques des Marais de Vilaine : 300 mètres environ de prospection de chaque côté de l'ouvrage sur les deux rives.
De manière très habituelle, ce sont les épreintes qui, parmi les nombreux autres indices éventuels (empreintes, reliefs de repas, catiches, places de miction, sécrétions vaginales, coulées, ressuis, etc.), ont été majoritairement mises à profit ici, en raison de la relative facilitée de leur découverte et aussi parce que « le dépôt d'épreintes est le critère le plus fiable, le plus durable et le plus probant pour déceler la présence de l'espèce sur un site. Il faut cependant avoir à l'esprit les limites de ces investigations, limites étroitement liées aux deux points suivants :
Il semble acquis que les femelles cessent tout marquage en période de mise bas et d'élevage des jeunes. Enfin, la quantité des marquages diminue considérablement, voire s'annule, dans les secteurs de basse densité de population. (Lafontaine, 2005), ce qui est actuellement le cas des Marais de Vilaine pour l'essentiel.
C'est à la fin de l'hiver et au printemps que les marquages territoriaux sont les plus abondants. Un deuxième pic de marquage a lieu à la fin de l'automne. En été et au milieu de l'hiver, les épreintes sont plus rares et les marquages territoriaux très peu renouvelés. » (Rosoux et Green, 2004.) Or, un certain nombre de nos prospections de terrain (D. Montfort) se sont déroulées en été, en raison des délais impartis pour la campagne de terrain.
Par ailleurs, selon le protocole de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN, Macdonald, 1990, et Reuther et al. 2000), la recherche des indices de présence devrait, pour être validée, être répétée au moins trois fois dans l'année, fréquence que, là encore, le cadre de la mission Natural 2000 n'a pas permis.
En plus des recherches de Ouest Aménagement, d'autres résultats, obtenus entre 2002 et 2006, par d'autres naturalistes ou associations (Bretagne Vivante/SEPNB, Collectif pour l'Inventaire des mammifères et des Ecosystèmes (CIMES) de Loire-Atlantique, Denis Fatin) ont été utilisés.
rois zones d'activité principale de la Loutre d'Europe semblent se dégager actuellement au sein des Marais de Vilaine :
- Les marais de Gannedel, de Murin et le Don
- La confluence de l'Arz et de l'Oust
- Et surtout, toute la partie sud regroupant la Vilaine en aval de Rieux/Fégréac, et l'Isac de Guenrouët à Théhillac. Cette grande zone inclut aussi les petites vallées affluentes du ruisseau du Moulin du Rocher et du ruisseau du Roho en rive gauche et du Trévelo en rive droite. C'est, selon nous, la plus vaste et la plus ancienne unité fonctionnelle des Marais de Vilaine pour la loutre d'Europe, où une population doit désormais être bien établie.
Ces résultats attestent, de manière désormais indubitable, les mouvements de retour en cours de la loutre d'Europe sur l'ensemble des Marais de Vilaine et des environs. Certaines zones d'activité principale plus circonscrites semblent s'y dessiner. Pour autant, l'actuelle dynamique populationnelle est telle que c'est bel et bien l'ensemble du réseau hydrographique et des zones humides des Marais de Vilaine qu'il faut prendre en compte dorénavant pour tout projet ou aménagement susceptible d'avoir un impact loutrologique, direct ou indirect. C'est d'autant plus important que la population de loutres des Marais de Vilaine est justement encore très vulnérable en raison de la faiblesse de ses effectifs
La protection de la Loutre.
L'une des principales causes de mortalité directe de la loutre répertoriées aujourd'hui en France étant représentée par les collisions routières, Ouest Aménagement a visité chacun des ouvrages, ponts et principaux passages sous voie du périmètre Natura 2000, afin d'en établir la dangerosité. À l'issue de cet inventaire, les ouvrages ont été cartographiés en fonction des exigences de l'espèce en matière de tirant d'air, de longueur busée ou de confort des berges et banquettes d'une part, du niveau de circulation automobile, spécialement nocturne, d'autre part.
Trois catégories d'ouvrages ont ainsi été formulées et cartographiées :
- Les ouvrages potentiellement très dangereux pour lesquels des fiches d'actions du Document d'objectifs doivent prévoir des « loutroducs ».
- Les ouvrages moyennement dangereux pour lesquels des dispositifs et des mesures spécifiques devront être programmés en cas de réfection ou de réaménagement.
- Les ouvrages inoffensifs, mais néanmoins à surveiller en fonction de l'évolution de la population
Le Ragondin
 Le ragondin connaît une rapide expansion en tant qu'espèce invasive et contribue à la fragilisation des berges. L'avifaune est surtout concentrée dans les zones de marais à proximité de l'exutoire.
Le ragondin connaît une rapide expansion en tant qu'espèce invasive et contribue à la fragilisation des berges. L'avifaune est surtout concentrée dans les zones de marais à proximité de l'exutoire.
(4)-Histoire des Marais
page suivante =Les Oiseaux
page précédente = les Insectes
